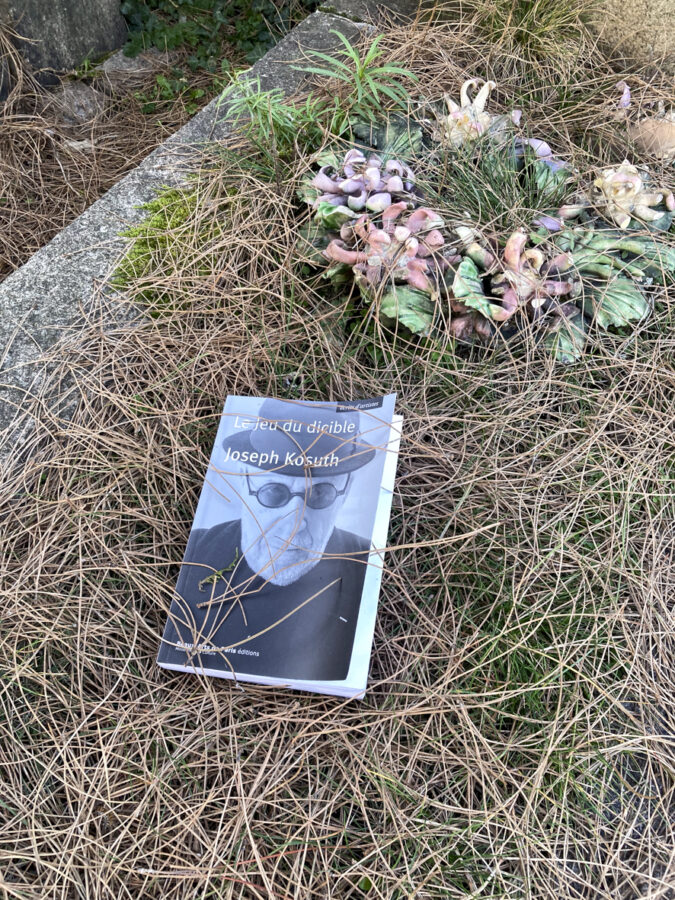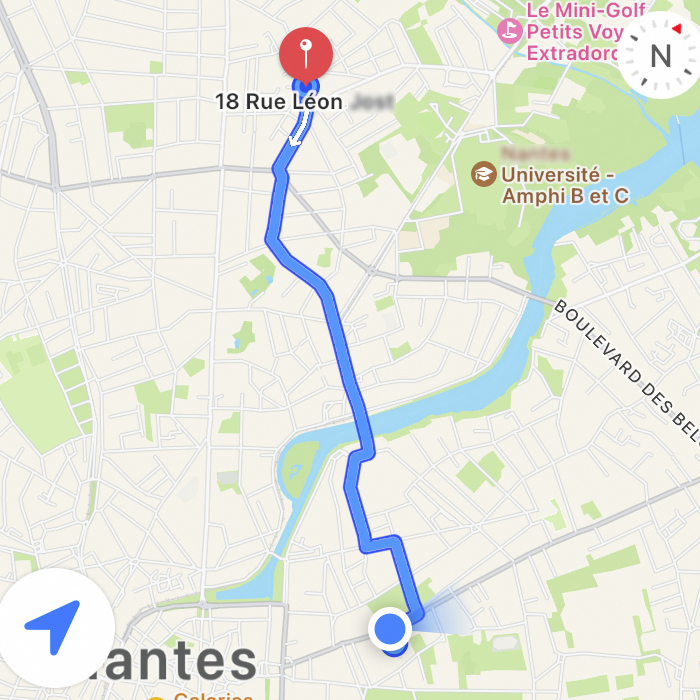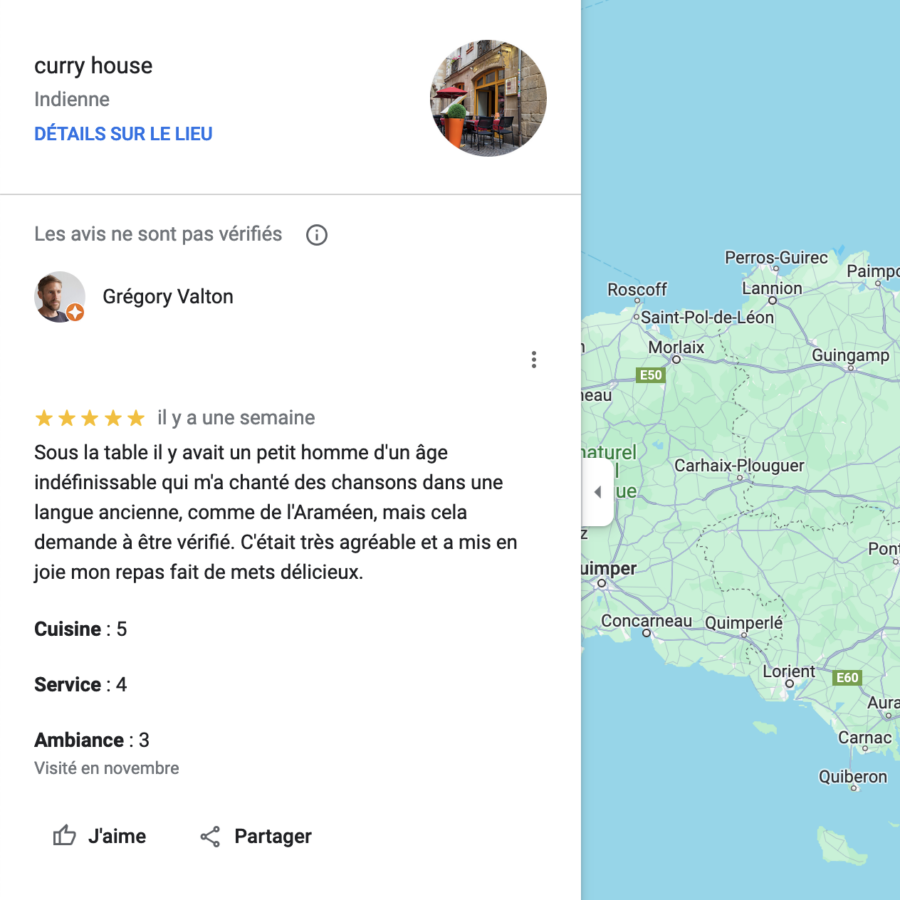Artistes
Grégory Valton : born 1975 in Paris, lives in Nantes, works in Nantes.
Résidence TransitionSLycée Bel-Air, Fontenay-le-Comte
La lumière qui traverse la ville, 2025Institut Français, Cluj-Napoca (Roumanie)
Point de chute – histoire d’une chute, 2023La Générale | Laboratoire artistique politique et social, Paris
Point de chute – la chute, 2023BLAST , Angers
Solo exhibitions
2025
- «Point de chute», La Chambre, Saint-Nazaire
2023
- «Point de chute», BLAST, Angers
- «Nos châteaux en Écosse», Maison des Arts, Saint-Herblain
- «Ce qui se repose», Divers lieux en partenariat avec le MAT, Ancenis
2022
- «Le soleil s’est endormi sur l’Adriatique», Atelier le Bras, Nantes
- «Nos châteaux en Écosse», La Gâterie, La Roche-sur-Yon
- «Nos châteaux en Écosse», Le PAD, Angers
2021
- «Nos châteaux en Écosse», Ateliers Bonus, Nantes
- «Nos châteaux en Écosse», Festival de la QPN, Nantes
2020
- «Ce qui se repose», Dispositif InSitu, Lycée Léonard de Vinci, Montaigu
2018
- «Glissé amoureux», Artothèque de La Roche-sur-Yon
2017
- «Glissé amoureux», Centre d’Art Le Village, Bazouges-la-Pérouse
2016
- «Au départ il n'y a rien qui va de soi», Site Saint-Sauveur, Rocheservière
- «Glissé amoureux», Centre d’Art de Montrelais
- «Ce qui se repose», Galerie Confluence, Nantes
2015
- «Glissé amoureux», Autour du lac de Grand-Lieu avec l'assoication L'esprit du lieu
2011
- «Glissé amoureux», Château d’Ardelay, Les Herbiers
Group exhibitions
2023
- «Nos châteaux en Écosse», Galerie Le Lieu, Lorient
2021
- «Nouvelles acquisitions de l'artothèque», École des beaux-arts de Nantes
2020
- «Boxon salin poésie tondue», Ateliers Bonus, Nantes
2018
- «Exposition inaugurale des Ateliers Bonus», Ateliers Bonus, Nantes
- «Festival L’Oeil d’Oodaaq», Ateliers du vent, Rennes
2017
- « Nouvelles acquisitions de l’artothèque», Musée Lurçat, Angers
2016
- «Quinzaine de la Photographie », Nantes
2012
- «Festival Manifesto», Toulouse
2008
- «Salon d’Art Contemporain de Montrouge», Montrouge
Residencies
2024-2025
- «TransitionS», Lycée Bel-Air, Fontenay-le-Comte
2024
- «Point de chute», Institut Français de Cluj, Roumanie
2023
- «Point de chute», La Générale, Paris
- «Point de chute», Collectif BLAST, Angers
2022
- «Nos châteaux en Écosse», Le PAD, Angers
2021
- «Night not-recording», École d’art de La Roche-sur-Yon
2017-2019
- «Nos châteaux en Écosse», Lolab, Nantes
2015
- «Au départ, il n’y a rien qui va de soi», Site Saint-Sauveur, Rocheservière
- «Glissé amoureux», Centre d’Art de Montrelais
2009
- «Glissé amoureux», Les Herbiers
Grants, awards
2024
- Aide à la mobilité - Institut Français + Ville de Nantes
2022
- Aide individuelle à la création - DRAC des Pays de la Loire
- Aide à la création des arts visuels - Région des Pays de la Loire
- Prix spécial du jury du Prix des arts visuels - Ville de Nantes
Publications, broadcasts
2025
- «La lumière qui traverse la ville», Auto-édition
2021
- «Entretien avec Eva Prouteau», Pôle arts visuels
2020
- «Entretien avec Fabien Ribéry», Revue L’intervalle
2017
- «La constellation», Thèse de Florence Jou - page 21 à 25
- «Glissé amoureux», auto-édition - Texte d’Hélène Chéguillaume & Entretien avec Frédéric Emprou
2016
- «Au départ, il n’y a rien qui va de soi», Éditions CCCR - Texte de Julien Zerbone
- «La photographie itinérante», Cité de l’architecture, Paris
2015
- «Une île, une forteresse», Livre de Hélène Gaudy - page 262 à 263
2011
- «Le pic entre deux ports», Éditions Poursuite - Texte de Sylvie Gracia
2008
- «Dans la neige», Éditions Poursuite - Texte de Sandrine Bailly
2005
- «Lendemains», Éditions Poursuite
Public and private collections
2021
- Collection de l’artothèque des beaux-arts de Nantes
2017
- Collection de l’artothèque d’Angers
2010
- Collection de l’artothèque de La Roche-sur-Yon
2005
- Collection de la Villa Pérochon - Niort
Workshops, teaching
2025
- Formation “Pratiques du livre d'artiste” - Leafy
2022
- Formation FSS techniques et régie de l’art - TALM / site d’Angers
Depuis 2022
- Formation sur Le livre d’artiste - Académie de Nantes
Depuis 2020
- Formation “Savoir photographier ses oeuvres” - AMAC
Depuis 2018
- Enseignant en pratique de la photographie - ECV Nantes
Depuis 2015
- Université de Nantes - Ateliers de pratique de la photographie
2010-2011
- Dispositif "Écritures de lumière" avec Camille Hervouet - DRAC des Pays de la Loire
Education, training
2024
- Master de l'École nationale supérieure de la photographie (ENSP) avec mention - Arles
2022
- DNSEP option Art avec les félicitations du jury - EESAB / site de Lorient
1998
- École des Métiers de l'Image / Les Gobelins - section prise de vue
Other
Depuis 2024
- Membre actif du réseau Les Factotums - Les petites écuries, Nantes
2022
- Commissariat de l'exposition "Format Papier" - Centre d’art Le MAT, Ancenis
2021
- Commissariat de l'exposition "Le livre comme finalité" - avec l'association PUI - Atelier le Bras, Nantes
2019
- Commissariat de l'exposition "L'espace du livre" - avec l'association PUI - Ateliers Bonus
2017-2023
- Suppléant du Collège Édition du Pôle art visuel Pays de la Loire
Depuis 2017
- Membre fondateur des Éditions Paris-Brest
Depuis 2015
- Membre fondateur de PUI (Pratiques & Usages de l’Image)
2014
- Membre du jury du Prix de La Quinzaine de la Photographie Nantaise
2012-2018
- Résidence La Métive (23) : bénévole (2012-2017) puis membre du CA (2017-2018)
Démarche
Grégory Valton a longtemps été photographe. Un photographe-marcheur, endurant et introspectif, un photographe-narrateur, racontant les histoires des lieux qu’il traverse et des êtres qu’il rencontre. Il y a dans ses œuvres une tension palpable entre la forte présence, parfois fantomatique, de son histoire familiale, et la tentative de s’en détacher. Un paradoxe entre l’expression nécessaire d’une subjectivité, l’acceptation d’un vécu personnel tragique, et le besoin primordial d’objectiver les faits, de les mettre à distance. Comme des souvenirs et des questionnements qui vous habitent et qui vous rongent, mêlés au souhait profond que jamais ils ne vous définissent.
Grégory Valton réactive les mémoires collective et individuelle par le geste. Il retourne sur les pas de Robert Desnos, déporté et décédé en 1945 en République Tchèque (La furtive, 2007-2022) et marche alors huit heures par jour, sur deux cents kilomètres. L’épuisement du corps se confronte à la dureté de l’Histoire. Il réalise l’inventaire des affaires de sa mère (L’inventaire, 2015), qu’il traite avec beaucoup de précaution, muni de gants blancs pour les manipuler. Le geste est précis et donne à l’objet intime le statut d’un sujet d’étude scientifique. Dans Ce qui se repose (2008-2023), il capture les paysages du village natal de sa mère et met en lumière la disparition et le manque d’un être cher, côtoyant ainsi l’absence et le vide.
Le vide appelle la chute. La pesanteur se dévoile, les corps s’évanouissent. Dans les performances et vidéos de la série Point
de chute (en cours), l’artiste sublime la rigidité du corps, le geste mécanique et la fragilité des objets dans les instants qui précèdent l’inéluctable. Une chorégraphie de l’inattendu, une délicatesse fortuite apparaissent dans ses installations, toujours en équilibre, sur le fil. A l’instar des textes de Samuel Beckett ou des vidéos de Bas jan Ader, qui l’inspirent, la simplicité et la précision des actions permet la répétition, la perte et le renouvellement du sens. La beauté de la persévérance de l’homme conduit à la vacuité du geste de l’idiot. L’artiste navigue en eaux troubles, entre rire contenu, référence tragique, absurde existentiel et idiotie, avec la chute comme seule boussole.
Le geste ultime de Grégory Valton, symbole à la fois du deuil et de l’histoire qui s’écrit à travers le prisme de l’absence, est le don de son appareil photographique argentique à un inconnu (La suppression des images, 2023). Il demande en contrepartie au donataire de lui envoyer ses premières photographies, prises avec la dernière pellicule de l’artiste. Le lâcher-prise est total, ou presque, le détachement se profile vers un renouveau certain. La fin d’une époque artistique et personnelle est marquée par cet acte symbolique de rupture et d’abandon, dans un mouvement d’ouverture de soi vers l’autre. L’artiste se déleste du passé pour partir, plus léger, vers d’autres horizons et expérimentations plastiques et performatives.
Marie Frampier
Entretien pour le Pôle arts visuels des Pays de la Loire - 2021
Vous dirigez les Éditions Paris Brest : avec d’autres éditeurs (FP&CF, Sur la Crête, Bleu de Berlin, Patayo, Zérodeux) vous contribuez au collège Édition du Pôle arts visuels Pays de la Loire. Comment avance votre travail de réflexion ?
Au sein du collège Édition du Pôle arts visuels, on discute beaucoup des problématiques de diffusion, communes à ces éditeurs indépendants. De nouvelles actions ont émergé grâce à ces échanges. Un mobilier est en cours de fabrication par les Ateliers Millefeuilles, en vue de présenter nos éditions en librairie. Une présentation est également prévue en avril 2021 au Lieu Unique pour un salon de la micro-édition, ainsi qu’au WAVE (Week-end des Arts Visuels). En parallèle, l’idée de faire tourner ce mobilier en galeries pendant les inter-expos nous semble pertinente, et des lieux comme la Gâterie, L’école d’art du Choletais et de Saint-Nazaire sont intéressés. Nous initions aussi des ateliers autour des éditions et des fanzines : au Lieu Unique, un atelier est ainsi programmé avec Hélène Mathorel de Bleu de Berlin.
Pouvez-vous retracer la genèse de Paris-Brest ?
Jusqu’à une quinzaine d’années, l’édition photographique était synonyme d’éditeurs mastodontes (Delpire, Xavier Barral, etc…), assez inaccessibles. Pour moi et quelques amis, il était clair que nos travaux photographiques avaient pour finalité l’édition. Seule l’édition indépendante pouvait nous permettre d’épanouir notre démarche. Je fus longtemps proche de Poursuite Éditions, qui éditent notamment Eric Tabucchi. À l’époque, cette maison indépendante tirait à 500 exemplaires, et un livre en payait un autre. Depuis, de nombreuses éditions indépendantes ont vu le jour, ce qui m’a donné envie de contribuer à cette efflorescence. Même phénomène pour les salons de la photo indépendants : en 2005, on se retrouvait beaucoup avec les illustrateurs, à Chaumont par exemple. Et petit à petit, les choses ont changé. La forme du salon m’enthousiasme : j’aime parler avec les gens de chaque projet, dans le temps long de sa maturation.
Comment travaillez-vous votre ligne éditoriale ?
Sur deux axes : j’édite des artistes à la sensibilité proche de la mienne, qui travaillent d’emblée pour la forme de l’édition ; mais je choisis également des projets d’artistes dont je suis le travail depuis longtemps, par exemple celui de Julien Quentel ou de Pierre-Yves Hélou, que j’ai trouvé judicieux d’amener vers la forme de l’édition. Parfois aussi, c’est l’occasion de projets plus expérimentaux ou d’essais de mise en page pour une édition plus importante à venir. C’est pour cela qu’il y a deux collections dans Paris-Brest, la collection Format, une forme assez légère inspirée de l’édition indépendante, imprimée à 100 exemplaires seulement, avec possibilité de réimpression sous forme de relecture ou de prolongement du tirage initial ; et la collection Hors-Format, pour des projets qui nécessitent un format particulier.
Quelle politique d’impression développez-vous ?
Je désire travailler localement, à revers des gros éditeurs qui impriment souvent en offset en Pologne ou en Lituanie pour tirer les prix. Je collabore donc avec un imprimeur des Herbiers, qui pratique une technique intéressante, l’Indigo HP, ce qui me permet de tirer à partir de 50 exemplaires, dans un format 18x26cm, sur 16 pages. Pour la collection Format, j’aimerais continuer à explorer ce support avec des gens très différents, notamment des artistes qui travaillent le son.
Parvenez-vous à dégager du temps pour votre pratique artistique personnelle ?
Comme de nombreux artistes, je jongle avec les cours, les ateliers, les associations dans lesquelles je suis investi et ma pratique artistique. Je prépare une conférence-performée autour d’une mythologie familiale, cela s’intitule Nos châteaux en Écosse, un projet entamé en 2017 qui mêle récit, artefacts que j’ai fabriqués à partir d’objets réalisés par mon grand-père, et sculpture en forme de château. Je pense donner cette performance dans la salle blanche des Ateliers Bonus en 2021. J’y interroge la notion de transmission, et je rajoute du faux au faux, en m’appuyant notamment sur La Guerre du Faux, ouvrage dans lequel Umberto Ecco écrit : « La vérité n’est pas historique mais visuelle. Tout semble vrai, donc tout est vrai. » J’ai tenu à enrichir une forme photographique exposée par une prise de parole où je me mets en danger, avec l’idée de la rencontre et de la circulation. Je commence aussi un programme de résidence avec l’école d’art de la Roche-Sur-Yon, autour de l’édition : avec les étudiants, nous allons concevoir un tiré-à-part en 50 exemplaires entre janvier et juin 2021.
Votre agenda semble bien rempli !
Oui, mais finalement, tout communique, je n’érige aucun mur entre ces champs d’action. Je suis également membre actif des PUI (Pratiques et Usages de l’Image) qui programment des temps de rencontres publiques, prenant pour objet le croisement du photographique et de l’axe thématique ville-territoire-environnement : avec cette structure, nous menons pour la seconde année un projet d’échange passionnant autour du livre de photographie avec le Québec. En fait, je suis persuadé que, loin de me disperser, cette profusion d’activités me nourrit de manière très cohérente.
Éva Prouteau
Revue l'intervalle - 2020
Offrant aux artistes très différents qu’il publie des cartes blanches, Grégory Valton, fondateur des éditions Paris-Brest (Nantes), aime que chacun de ses ouvrages invente une forme nouvelle adéquate à son propos.
A première vue déroutants, ces opus se présentent souvent comme des recherches en cours, s’inscrivant pleinement dans le champ de l’art contemporain dans la mesure où sont interrogées chaque fois les possibilités et les limites du médium photographique.
Il ne s’agit pas de produire systématiquement du bel ouvrage, mais d’entrer dans des laboratoires de création, la dimension plasticienne de chaque objet produit outrepassant la logique du livre de photographie traditionnel.
A l’occasion de ses quatre dernières publications, j’ai souhaité donné la parole à Grégory Valton, afin de témoigner en toute connaissance de cause de la fine intelligence de ses auteurs.
Barrage de Sarrans, de Sandrine Marc, est un très beau livre paysager consacré au barrage hydraulique aveyronnais, vidé en 2014. Des chemins se découvrent, des ruines, et l’étonnante présence d’une espèce végétale pionnière, la renouée persicaire. Les éditions Paris-Brest ne sont-elles pas particulièrement sensibles à la façon dont le temps rencontre les lieux ? Avec Barrage de Sarrans, c’est comme si l’on entrait dans une archéologie vivante. Les couleurs des images ont-elles été repensées durant le moment de l’editing ?
Barrage de Sarrans est réalisé lors de la vidange du barrage hydraulique dans la vallée de la Truyère dans l’Aveyron, en 2014. Durant une journée, Sandrine va arpenter ce paysage transformé et choisir de montrer ces vingt photographies. C’est vrai que l’on retrouve un lien au lieu et au temps (Thomas Bouquin, Benoît Grimalt, Sara A. Tremblay). Ces préoccupations traversent mon travail, donc j’y suis forcément sensible. Mais une carte blanche est donnée aux artistes, donc je ne pense pas aiguiller le choix du projet à présenter. Je pousse à aller vers une forme expérimentale. Mais la photographie reste appliquée, malgré elle.
Sandrine s’est complètement accaparée le livret et l’étui. C’est une photographe très consciencieuse qui produit depuis quelques années ses propres éditions/multiples. Elle prête une grande attention, un soin particulier à l’éditing, à la maquette. Pour ce livret, Sandrine a pris le contrôle de tout, de la mise en page à l’impression. Et les couleurs et les noirs et blancs ont soigneusement été préparés. De plus, l’étui a complétement été réinvesti et la forme du Paris-Brest s’en trouve renouvelée. Son livre est devenu une référence pour les nouveaux artistes invités. Et j’espère que la forme va encore bouger, au fur et à mesure des cartes blanches.
Smile ! de Julien Quentel se présente sous la forme d’un poster plié sous agrafes. Qu’est-ce que ce livre montrant une structure jouant de façon ironique avec l’écœurement ? Est-ce un memento mori ?
Julien a longtemps réfléchi à la forme de l’édition, à son sens, à sa finalité et fait plusieurs tentatives de mise en page avec la taille imposée par la collection. Il souhaitait exploiter le maximum de surface de papier dans une seule et même page. Contrairement aux autres Paris-Brest où le défilement de pages amène à une narration, Julien souhaitait un autre possible, d’où cette proposition d’une seule image sur une seule face. La forme du poster a ensuite été pliée et agrafée à l’étui, obligeant le manipulateur à démembrer la publication, laissant des stigmates sur l’image. L’objet mutilé devient alors lacunaire, dans un acte qui fait sens pour celui qui l’accomplit.
Le choix de l’image reproduite de la portière, membre esseulé d’une automobile, a longuement été réfléchi. Elle est accrochée au mur, sur un fond neutre, la prise de vue est frontale. La pièce reproduite a donc a été pensée pour être exposée. Le poster vient clore l’action. Puis il y a ce détail sur l’étui, cette glace avec des copeaux de chocolat. À y regarder de plus près, ce sont des abeilles engluées. Comme des reliques macabres du monde industriel et naturel, dans un aveu d’incompatibilité. Smile ! est un memento mori aux accents ballardien.
Parmi, de Sara A. Tremblay est un livre de tonalité élégiaque, célébrant la grâce du simple et des éléments de la nature. Quelle place occupe cet opus horacien dans votre structure éditoriale ?
Parmi, est un titre en suspens. C’est l’été au Québec, dans le nouveau lieu où réside Sara, en campagne. Elle est au milieu de la nature, au bon endroit, sans sa vie d’avant et se laisse porter par les jours, les éléments. Ce livret raconte ça. C’est comme une mue, un renouvellement, c’est avant l’hiver où la vie se passe à l’intérieur. Là, c’est dehors. C’est un temps suspendu, et Sara est aux aguets, à l’affût de ce qui l’entoure. Peut-être comme la découverte ou la redécouverte d’un nouvel environnement. Il y est question d’envahissement, d’expérimentations, de formes, de gamme chromatique, de retour sur des traces, de lumière, d’instant. Et puis l’autoportrait qui nous interroge, nous prend à témoin. Et la maison à la fin qui apporte du mystère, avec l’étui qui forme comme une peau de protection. Oui, c’est un long poème, et en l’écrivant, cela me donne envie de proposer à Sara un Parmi, sous la neige…
Le livre Conservation, dépliable à la façon d’un accordéon, est le premier de cette sorte publié par votre maison d’édition, non seulement concernant sa forme, mais aussi son contenu, composé d’images hypnotiques, flottant entre peinture et photographie. Qui sont Thérèse Verrat et Vincent Toussaint les auteurs de cet ouvrage singulier ? Comment ont-ils travaillé ensemble ? De quelle nature sont les images ici présentées ? Pourquoi ce choix éditorial ?
Thérèse et Vincent sont un duo d’artistes qui vivent à Paris. Ils ont exposé la série Forma cet hiver durant Photo Saint Germain. Ils travaillent avec une seule caméra l’un contre l’autre, l’un avec l’autre, l’un et l’autre. Les formes qu’ils produisent interrogent le réel, mais sont insaisissables. Car il s’agit bien de formes, d’objets-images qui sont montrés. Pour citer Virginie Huet, qui signait le texte de l’exposition : « Pour comprendre ce qui les lie, il faut dresser l’inventaire des formes curieusement familières peuplant leur répertoire sans âge, du moins plus antique que d’aujourd’hui ».
Conservation est une série de neuf photographies sans images, neuf plans-films qui ont été conservés dans le congélateur, puis qui ont été révélés aux regards. Dans la salle d’exposition, ces images, abstraites, sont montées sous verre cerclé de plomb et posées sur des podiums. Elles se regardent recto-verso et nécessitent un déplacement du corps. Thérèse et Vincent ne savent pas non plus si les formes produites sur les plans-films, une fois exposées à la lumière, vont résister au temps car elles n’ont pas été développées ni fixées. Peut-être que la révélation va se prolonger. Cela parle de photographie, mais de manière indicible et me renvoie aux images de Philippe Gronon qui invente des objets photographiques capables d’emprisonner quelque chose (et me renvoie aux icônes). D’où peut-être la nécessité d’en faire une édition avant que « cela » ne disparaisse. Je pense que c’est cela qui m’a plu et qui collait bien avec Paris-Brest : cette manière de parler d’un médium mais sans le montrer, de brouiller les pistes. Ensuite, j’ai vu Thérèse et Vincent et pas mal de choses me liaient à eux (dont le travail à deux). Ils m’ont proposé la forme du Leporello qui présente les plans-films au format, de manière très simple. Ce projet est une collaboration avec les graphistes T&D studio (encore un duo) et nous avons imprimé chez Escourbiac pour l’ouverture de l’exposition.
Chaque nouveau livre se présente-t-il pour vous comme un défi formel ? Êtes-vous davantage lu, vu, regardé, par le monde de l’art contemporain que par celui venu des livres de photographie traditionnels ?
J’aimerais penser l’ouvrage sans sa forme « livre », le penser comme un objet, incasable dans sa bibliothèque mais qui pourrait être présenté en galerie. Je pense ici à des objets-livre comme AULT de Thibaut Brunet publié chez Mille cailloux ou la collection « Saison » montée par Filigrane entre 2003 et 2008 (format et nombre de pages imposés). Je pense Paris-Brest comme un laboratoire, où les artistes tentent des expériences. Le format imposé de la collection « Format » (18×26 cm – 16 pages) a été voulu au départ pour que les artistes repensent, dépassent et créent une forme dans la forme.
Ensuite, étant artiste, je suis volontairement plus présent dans les réseaux de l’art contemporain que dans celui de la photographie. Les livrets « Format » sont des objets sans textes (depuis 2019), assez froids, et loin des belles factures des livres de photographies. Je trouve que les plasticiens dans l’exposition, ont dépassé la question de la mise en espace, de l’accrochage. Cela fait bouger ma pratique artistique donc les éditions que je propose vont dans le même sens.
Comment et où présentez-vous vos livres ? Comment les défendez-vous dans une production française et internationale devenue pléthorique ?
Je mets les livres en dépôt dans quelques librairies telles que la Librairie Sans Titre et Le Bal à Paris ou bien la librairie de la HAB à Nantes, qui sont tournées vers une ligne éditoriale contemporaine. Cela est plus facile avec le livre de Thérèse et Vincent (Conservation) car il a un « vrai » statut (couverture cartonnée, belle impression), qui est plus facilement repérable dans les rayons. Les titres de la collection « Format » (18×26 cm – 16 pages), sont vite dilués parmi les autres ouvrages. Lorsque 12 livrets seront sortis, je pense faire un coffret pour donner plus de consistance/matière à cette collection. Mais mon moyen de diffusion de prédilection reste le salon. J’essaie d’en faire un par an (Rolling Paper au Bal, Mise en Pli #2 au FRAC PACA et Revue #1 à l’ENSBA de Nantes). J’aime expliquer aux gens comment se construit la collection, la manière qu’a eu chaque artiste de procéder.
C’est vrai que la production de livres, surtout de photographie, a explosé ces dernières années. Diffuser son travail par le livre est plus simple que de trouver un lieu intéressant/décent pour exposer ses photographies. Cet attachement des photographes à l’ouvrage n’est pas récent puisqu’il est apparu avec American photographs de Walker Evans (la scission entre livre de photographies et livre de photographe date du début du XXème). Pour ma part, je me suis volontairement glissé à la lisière de l’art contemporain, en creusant le champ de l’image au sens large. Ce sont des cartes blanches faites à des artistes, donc certains livrets ont un aspect rugueux, difficilement pénétrable et d’autres livrets (ceux des photographes) sont peut-être plus lisibles. Ici, je défends aussi l’impression chez des imprimeurs situés à moins de cent kilomètres d’où je réside. Le livre-poster de Julien Quentel a été imprimé à sept stations de tramway de chez moi, en offset et à cent exemplaires ! Avec les éditeurs de la Région des Pays de la Loire, nous développons ainsi un réseau d’imprimeurs locaux. Nous réfléchissons ainsi à une économie solidaire et écologique du livre.
Comment bâtissez-vous la cohérence de votre maison d’édition, déjà riche de huit titres ?
Je continue de travailler avec des artistes dont les projets ont une cohérence au sein de Paris-Brest. En 2020, Alma Charry, Myriam Gaumond et Karine Portal vont investir chacune un livret « Format ». Il va s’agir de dessins, d’installation, de photographie, d’archives, toujours dans une forme libre et expérimentale. Je n’interviens en rien dans la maquette des artistes, sauf s’ils me le demandent. La cohérence fonctionne au coup de cœur je crois, mais le risque est à la longue de tomber dans une répétition des « écritures », ce qui pourrait arriver si je n’invitais que des photographes. C’est pourquoi j’ai ouvert le champ aux plasticiens ayant des pratiques pluridisciplinaires.
Ensuite, pour la collection « Hors-Format », j’essaie de développer un ou deux projets par an, car cela prend du temps. Les artistes me contactent car ils sentent qu’il y a quelque chose à faire avec Paris-Brest. Le nom y joue pour beaucoup. À Rolling Paper, une personne est venue me voir juste parce qu’elle aimait le nom de la maison d’édition. C’est avant tout une histoire de rencontres. Le projet vient ensuite. C’est comme ça que le livre s’est fait avec Thérèse et Vincent. Cette année, deux autres livres de cette collection vont paraître : Paris bonjour au revoir de Benoît Grimalt, traversée de Paris de la Porte de Clichy à la porte de Choisy en empruntant les rue qui commence par la lettre C (voir Espèce d’espace de Pérec) et un livre avec Mathias Pasquet qui va retranscrire une résidence de recherche. Je suis plus présent sur ces ouvrages car nous pensons ensemble la forme du livre, le déroulé, le chemin de fer, le format,…
Fabien Ribéry
Revue L'intervalle - 2018
Fondateur à Nantes des éditions Paris-Brest, Grégory Valton publie, à un rythme de trois fois par an, des livres de seize pages et de format invariable conçus comme des espaces d’expérimentation pour des travaux d’artistes (photographes/plasticiens) de natures très diverses. Est ici valorisée une prise de risque, une volonté de ne pas être parfait, une ambition de recherche, les artistes montrant davantage leur processus de travail qu’une production impeccablement finie.
Ses deux derniers livres Interlude, de Benoît Grimalt, et La peinture, c’est comme les pépites, de Pierre-Yves Hélou, peuvent paraître au premier abord déroutants, mettant le lecteur au travail, et l’invitant à élaborer un protocole de lecture très personnel.
J’ai souhaité en discuter une nouvelle fois, après un premier article publié il y a quelques mois dans L’Intervalle, avec Grégory Valton. Où l’on comprend que la notion de ratage en art relève d’une logique moderniste désormais très largement inopérante.
Après Le Roc d’Ercé, de Thomas Bouquin (livre présenté dans L’Intervalle), vous publiez Interlude, de Benoît Grimalt et La peinture, c’est comme les pépites. C’est pas forcément quand tu cherches que tu tombes dessus, de Pierre-Yves Hélou. Comment concevez-vous dans votre jeune catalogue l’articulation de ces trois livres ? Selon une logique de complémentarité, de contrepoint, d’associations d’idées, de parallèles ?La parution de trois livres par an fait partie des fondements de la maison d’édition. Cela me permet de donner un rythme au catalogue, qui se constitue en fonction de mes points d’intérêts artistiques, de mon réseau, ainsi que de proximités professionnelles et personnelles. L’articulation des ouvrages ne se définit pas par des sujets ou des idées, mais bien par l’espace d’expérimentation du livre. Je conçois Paris-Brest comme un espace vierge de 16 pages et de format invariable. Ce qui m’intéresse c’est la façon dont les artistes investissent cet espace et comment cela leur permet d’aborder différemment leur travail. D’où aussi la diversité des points de vues proposés, que ce soit des travaux d’artistes photographes ou plasticiens.
Pensez-vous vos livres dans la continuité des rencontres de réflexions autour des images organisées par l’association PUI (Pratiques et Usages de l’Image), dont vous êtes cofondateur ?
C’est vrai qu’il y a une continuité avec les rencontres que nous organisons avec PUI. Surtout sur la question de l’utilisation de l’image qu’en fait l’invité, qu’il soit chercheur, artiste, écrivain ou photographe. Nous pensons qu’une rencontre est réussie lorsque celui-ci repart avec des questions qu’il ne s’était pas forcément posé. C’était aussi avec cette idée que j’ai construit Paris-Brest : pourquoi l’artiste présente ce projet, comment faire avec des contraintes imposées dues au format du livret et au nombre de pages… Les rencontres, comme l’édition ou l’exposition, sont les endroits pour réinterroger sa pratique.
De quelles problématiques vos derniers deux livres sont-elles nourries ? Les imaginez-vous comme des objets de recherches pures ?
Les problématiques liées aux deux derniers livres sont d’ordre général. Les livres de photographies sont souvent très bien réalisés, mais la plupart du temps les images de l’exposition sont également celles du livre. Un peu comme un concert où le groupe rejoue note par note l’album qu’il a enregistré. J’ai tendance à aller vers des groupes qui déconstruisent, réinterprètent leur musique ou leurs sessions d’enregistrement (je pense par exemple à Smile sessions des Beach Boys). Les livres édités chez Paris-Brest sont pensés comme des objets de recherche, d’expérimentation, dans lesquels les artistes montrent les ratés, les bouts d’essai, les tentatives, où ils prennent des risquent.
Chaque année, j’envisage de présenter deux projets différents, où serait accordée moins d’importance au médium photographique, que je trouve parfois trop précieux. Benoît Grimalt édite le making of d’un film réalisé en résidence, où les dessins sont des idées de plan, les photographies sont voilées à cause d’une chambre noire défectueuse. Pierre-Yves pratique la photographie comme une esquisse. Ne retrouvant pas toujours dans le travail d’atelier la même énergie que sur l’instant, il en vient à considérer ses images comme des photographies-sculptures.
Pierre-Yves Hélou est un plasticien. Pourquoi ce choix ?
Je ne me retrouve pas trop dans le paysage photographique nantais, d’où l’envie d’organiser des rencontres autour de l’image avec PUI, ou de développer la partie éditoriale avec Paris-Brest. Je fréquente surtout des plasticiens qui utilisent la photographie comme un outil appliqué, pour rendre compte de leurs œuvres dans leurs expositions, par exemple. Le choix d’inviter un plasticien qui travaille en trois dimensions est important pour moi. Avec l’édition, les artistes ont un espace vierge dans lequel ils peuvent pousser la réflexion de la place et de la représentation de la sculpture ou de la performance.
Pierre-Yves glane des matériaux de chantiers qu’il archive dans son atelier. Certains sont assemblés, réorganisés par formes, textures, et tout joue sur l’équilibre. Lors de ses expositions, certaines de ses œuvres se sont retrouvées par terre. Pierre-Yves n’a pas cherché à les reconstruire, il les a laissés tels quels. Son livre est né de la même manière, d’une erreur à l’impression de la maquette. Tel un ready-made, par inadvertance, le livre a trouvé sa scénographie. Pour se rassurer, le lecteur peut alors découper les pages, refaire la maquette, recoller les photos entre elles.
Votre ambition est-elle de permettre à vos lecteurs, à l’instar de la collection Cahiers de Soraya Amrane (Zoème/ Filigranes Edtions), de découvrir les coulisses de la création ?
J’avais acheté les deux premiers Cahiers (Arja Hyytiäinen et Nina Korhonen), car j’aimais bien l’idée du carnet de recherche, de ce qui n’est pas montré en photographie : le déchet, la photo ratée, la complicité entre texte et image… Paris-Brest se situe entre l’atelier et la présentation, il ne s’agit pas de rejouer une recherche existante, mais bien de proposer un espace de liberté et de confiance. Les artistes ne sont pas forcément connus, il n’y a pas d’enjeu éditorial, je leur laisse champ libre et, parfois cela fonctionne, parfois non. L’espace éditorial leur permet en tout cas de réinterroger leur travail, de le bousculer, d’aller vers des chemins plus escarpés.
La question de l’archive est centrale dans la création contemporaine. Y a-t-il dans votre démarche éditoriale une volonté de constituer petit à petit une mémoire de l’infime et du hors-champ ?
Si l’archive et la mémoire ont une place importante dans mes travaux d’artiste, je vois plus Paris-Brest comme une collection, presque un cabinet de curiosité où cohabitent des corpus variés. Il faudra du temps pour dire si cet ensemble constitue une archive et je risque de perdre les chercheurs qui tenteront d’établir des liens et des connexions entre les différentes parutions ! La liberté que j’offre aux artistes dans l’espace du livre, je me l’autorise également dans la diversité des approches. Peut-être qu’en effet les formes peu visibles et fragiles seront un axe reliant certains des travaux édités, mais cela tient plus à ma sensibilité et à mes préoccupations actuelles, qu’à une volonté de s’inscrire de façon cohérente dans le temps.
Comment s’inscrit Paris-Brest Publishing dans le territoire nantais. Qui sont vos soutiens et partenaires éventuels ?
Je ne suis pour l’instant soutenu d’aucune sorte et je mène ce travail éditorial bénévolement, grâce aussi aux photographes et artistes qui donnent de leurs temps. Depuis deux ans, Paris-Brest fait partie du Collège Édition du Pôle arts visuels des Pays de la Loire. En ce moment, nous mettons en place un annuaire des lieux de diffusion des livres et des maisons d’édition en région. Je commence à rencontrer, dans des salons, d’autres éditeurs nantais comme FP&CF, Chambre Charbon ou Bleu de Berlin. Je diffuse très peu par le réseau des librairies, mais je pense le faire un peu plus localement en 2019, peut-être par le biais de signatures, quand le catalogue sera un peu plus étoffé.
Quel bilan faites-vous de votre première année d’éditeur ?
Monter une maison d’édition me permet de garder une veille sur les travaux d’artistes, les livres édités, les expositions. Je prends beaucoup de plaisir à rencontrer les artistes, à faire paraître des travaux qui me tiennent à cœur, à créer et renforcer les liens avec les photographes québécois, à être présent lors de salon (trois cette année dont le FRAC PACA en novembre pour Mise en pli #2), à échanger avec d’autres éditeurs. Pour l’année prochaine, seront édités les travaux de Sara Tremblay (QC) en mars, de Sandrine Marc en juillet et de Julien Quentel en octobre. Le prix de vente va aussi changer, car je vais proposer le livre à 10 euros et à 15 euros, accompagné d’un tirage de tête.
Fabien Ribéry
Glissé amoureux - 2017
Le chuchotement muet de Roland Barthes se lit en filigrane de Glissé amoureux, une œuvre que Camille et Grégory mènent, à deux et par petits bouts, depuis plus de cinq ans. Fragments d’un discours amoureux est le point de départ de leur réflexion, à la fois fil conducteur et rhizome de cette forme d’hommage, singulier et protéiforme, que les artistes rendent à l’auteur. En une succession de haïkus « à géométrie variable et entrées multiple » qui coexistent sans qu’ils ne s’engendrent, les artistes dressent un portrait mouvant du sentiment amoureux. La cohérence s’affirme heuristiquement dans cette dispersion où tout fusionne.
C’est dans l’interstice de tableaux changeants que le projet affirme l’ambiguïté de son premier point d’ancrage, alors qu’il tisse l’aurore de son propos. La rencontre signe le début du glissement vers le collectif. Comme à travers le trou d’une serrure, Camille et Grégory dévoilent subtilement leur genèse. Fragments écrits, sonores et visuels brouillent déjà les cartes du vécu avec celles d’une projection fantasmée. En parallèle de cet état des lieux, ils se lancent à visages découverts dans la thématique qui leur est alors proposée d’explorer : le couple et le territoire.
Le projet devient objet : celui du sentiment, socle métaphorique, muable mais impalpable, que les artistes transportent au fil de leurs rencontres et de leurs errances. Ils le conjuguent à tous les temps, le soumettent à divers états et lui accordent de multiples formes, dans une valse perpétuée entre l’intime et l’universel, le paysage intérieur et l’environnement extérieur.
Glissé amoureux implique, dans sa définition, la nécessité d’une rhétorique photographique commune qui évolue à mesure que les artistes développent leur dessein. Manières et points de vues se confrontent, se frottent et se compromettent.
Arpenteurs, les photographes cherchent un cadre idéal. Ils enclenchent le retardateur. A ce stade, tout est sous contrôle, sauf le sujet. Dix secondes pour s’extirper de sa peau d’auteur et peaufiner son jeu d’acteur.
Dix secondes pendant lesquelles chacun prend connaissance de son corps, en proie à la capture. Dans les tableaux, leurs présences trompent l’œil. Un jeu de séduction et de confusion témoignant surtout d’une expérimentation performative : l’architecture d’un couple.
Le film L’Aurore de Murnau est une souche sur laquelle les artistes viennent régulièrement se reposer : Une histoire « de nulle part et de partout. Qu’on peut entendre n’importe où et n’importe quand. Partout où le soleil se lève et se couche. (…) La vie est parfois amère et parfois douce » .
Glissé amoureux est une histoire sans début ni fin, rythmée par le mouvement constant d’un balancier entre le je, le nous le vous, le rapport à l’autre, aux autres… La figure de la « Dame de la ville » nécessaire à Murnau pour allégoriser le trouble est ici inutile, celui-ci étant incarné par le langage corporel de Camille et Grégory.
Ici, la lumière vient modeler les chairs d’une étreinte anonyme semblant être sculptée à partir d’un seul bloc. Puis la torpeur cède à une froideur quasi clinique lorsque les visages apparaissent, figures de cires à l’abri d’un habitacle périurbain. Ailleurs, le paysage esseulé confirme le sentiment amoureux. Parfois, le cadrage se resserre sur un fragment de végétation, évoquant la peinture de Jackson Pollock autant que le papier peint familial.
Embrasser le lac dans son ensemble est une tache impossible. Second temps de la fugue, il se diffracte, se condense et s’étire, apparaît comme une véritable matière première, alors que le climat modèle les ambiances. Les personnages des images se heurtent à des émotions contradictoires, frustrantes et pleines. Emprunter des voies sans issues, s’entêter, se perdre ou tourner en rond, l’œuvre se teinte d’interludes exprimant doute, tension, combat… La perte de repères apporte une topographie jusqu’alors inédite : le tracer des cheminements d’une idylle.
Faire œuvre à partir du couple est un exercice périlleux, tant cette thématique peut paraître tour à tour surannée ou mièvre. Le recours aux archétypes et autres lieux communs sont alors joués, sur joués, déjoués et enfin dépassés. Les anachronismes sont des pièges que les artistes esquivent autant qu’ils s’y laissent prendre.
Faire œuvre à partir de son propre couple ne se veut pas non plus narcissique. Le projet s’étaye d’échanges généreux lorsque Camille et Grégory vont à la rencontre des habitants leur proposant, par exemple, d’accueillir une photographie. A l’inverse, ils récupèrent volontiers des clichés amateurs de couples pour les mettre en scène le temps d’une exposition. Le corpus initial s’étoffe également d’herbiers remémorant des promenades complices avec le public.
L’équilibre retrouvé. La maturité acquise permet alors une approche maitrisée, plus théâtrale, pourtant sobre et dépouillée. Les artistes creusent la question de l’intime, réduisant encore un peu plus la distance entre l’appareil et ses sujets : les corps et l’environnement minéral et végétal, pour une précision, solution révélatrice de l’universel. Tout est dans le fleuve. Ses paysages apportent une redéfinition du couple auteur et acteur. Etre le support de l’autre, se supporter sans s’absorber, une résistance, mesure de protection visant à ne pas se laisser happer par la roue de Plutchik . La Loire aussi a ses tourbillons qui entrainent les photographes à questionner à nouveau le cadre, dont le hors champs est une échappatoire à ses forces centrifuges.
Une nouvelle page se tourne tandis que Glissé amoureux gagne son statut d’objet, incarné par un livre, terreau et valise, que les artistes bouturent pour nos pérégrinations amoureuses.
Hélène Chéguillaume
Glissé amoureux - 2017
Pourquoi avoir donné ce titre à cette série photographique que vous signez à deux ?
Son côté un peu fleur bleue est assumé car il offre plusieurs degrés de lecture. Ce titre traduit à la fois l’idée d’un glissement entre deux photographies et la réunion fortuite de deux démarches plastiques. Il désigne un homme et une femme qui se rencontrent à travers un album d’images. Les vignettes de Glissé amoureux représentent deux personnages qui traversent des paysages et incarnent les états d’un couple possible. Mais l’ensemble du projet Glissé amoureux s’envisage comme une combinatoire entre les deux photographes que nous sommes : en allant chacun vers la pratique de l’autre, nous avons sans cesse glissé d’une attitude à l’autre au cours de ce projet.
Y-a-il une référence aux Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes ?
Le livre de Barthes a accompagné nos recherches et nos expérimentations quant à certaines de ses définitions au début du projet en 2009, mais nous nous en sommes progressivement détachés. Pour résumer et emprunter une tournure presque barthienne, Glissé amoureux parle de ce moment où les choses se croisent et de l’endroit où celles-ci s’entremêlent. Il y a donc toujours l’idée de ce qu’il va rester de ces éléments et de ce que l’on en gardera à la fin. Cela renvoie pleinement au médium photographique.
Comment ce projet a pris forme ?
De nous même, nous ne serions jamais allé vers une forme pareille. Avec des pratiques extrêmement différentes, il ne nous était jamais venu à l’esprit de travailler ensemble. Suite à une invitation en résidence conjointe, nous avons commencé par collecter des photographies amateurs chez certains habitants de la ville. Nous avions fait le constat assez drôle que nous n’avions aucunes images de nous deux. Les gens nous ont prêté les leurs pour qu’on les intègre au projet, elles devaient servir à construire nos mises en scène et nos propres productions. Du documentaire, nous sommes passés ainsi à la fiction. Petit à petit, notre intérêt s’est porté sur la photographie ratée, floue ou pas cadrée. En tant que photographe, on veut toujours tout maîtriser, là, l’idée c’était de choisir des poses pour faire des choses plus spontanées et naïves.
Comment définiriez-vous la relation qu’entretient le couple avec ces diverses toiles de fond ?
Les situations que vivent ces deux personnages sont induites par les paysages. Nous ressentons et interprétons quelque chose face à un paysage, ensuite nous le faisons jouer à ces deux personnages. Pour qui regarde l’image, cela creuse d’autant plus le doute quant à une donnée autobiographique. Pour nous, il est très clair qu’il ne s’agit pas de nous, mais nous aimons bien entretenir cette ambiguïté. On se retrouve constamment entre le réel et la fiction avec ces niveaux de lecture qui s’empilent.
Il y aurait donc un phénomène d’analogie entre ce couple et ces différents territoires, l’un se laissant impressionner par les autres ?
En effet, tout passe par le prisme de l’homme et de la femme. Les images autours du lac se sont construites par la frustration générée de ce que l’on vivait physiquement sur ce territoire : un sentiment d’être tout le temps bloqués par le végétal. En fait, cette idée de l’inaccessible coïncide avec l’état ou la posture du couple. Dans la séquence aux abords du fleuve, la question du hors champ apparaît parce qu’il y a cette eau qui coule en face et qui développe la sensation que ces images n’ont ni début ni fin. De la même qu’il y a des tourbillons dans le fleuve, on a cherché à évoquer cet élément avec les deux personnages et leurs mouvements par exemple. Il y a toujours une influence entre ce que l’on voit et ce que l’on sent du territoire dans ce que l’on va construire par la photographie.
Le passage d’une photographie à une autre fait vraiment penser à des séquences cinématographiques…
Le film de Murnau L’aurore est une référence clé du projet. Son scénario s’articule avec des transitions entre des paysages contrastés qui organisent le film et l’histoire des deux protagonistes centraux. Pour chaque espace traversé par le couple, les personnages développent une relation ou un état différent du couple. Glissé amoureux reproduit cette association entre des arrière-fonds et les deux personnages : nous avons essayé de sentir à chaque fois dans les paysages ce qui peut se passer pour les personnages que nous incarnons.
Le spectateur a l’impression de zones de lisière ou de suspens comme si un dévoilement n’arrive jamais à terme dans l’image…
Les cadrages et les intérieurs de ces photographies sont bien la preuve que l’on recherche des décors. En voulant définir et jouer ces différents états du couple à travers tous ces endroits, nous avons cherché des espaces anonymes ou génériques. Le bourg rural s’est envisagé comme un décor à part entière, le paysage traversé y est peu remarquable. En fait, ce sont les non lieux qui nous intéressent comme pour le film de Murnau, ce pourrait être ici et partout. On essaie toujours de triturer quelque part cette notion de reconnaissance qui est très liée à la question photographique. Est-ce que je reconnais cela ? Est-ce du réel ou pas ?
La vidéo qui montre le couple errer dans la nature semble générer l’idée du non lieu global et d’une promenade sans fin…
L’élément paysager est très important parce qu’il engendre notamment la contemplation. Le fait de multiplier les images qui se télescopent ou les situations qui se contredisent, favorise la perpétuelle recherche des trajectoires qui glissent l’une vers l’autre et qui se croisent entre elles. En fait, nous avions besoin que ce couple se déplace ou s’anime avec son environnement, et en même temps d’une certaine manière que ce paysage vive avec lui.
Peut-on parler d’une mise en abyme quant à votre présence à l’intérieur du cadre plutôt que derrière l’objectif ?
Quelque part, c’est le retardateur qui fait les choses. Durant ces dix secondes de temps qui s’étirent, le photographe est complètement dépossédé : en appuyant sur le retardateur, nous ne déclenchons pas la photographie. Et de l’autre côté de l’appareil, il y a cette pensée précise de l’image que l’on est en train de faire, alors que lorsque l’on appuie sur le bouton directement, il n’y a pas la même conscience de cette image. Le fait aussi d’incarner une scène implique une relation différente avec tout cela : une conscience du corps, de l’expression et de la posture. Malgré le fait que l’on pourrait croire que l’on se retrouve dans un lâcher prise, la présence dans le cadre donne la sensation de contrôler beaucoup plus l’action.
Pensez-vous poursuivre ce protocole à d’autres endroits ?
Il y a ce constat que nous n’avons pas encore travaillé dans un réel espace urbain. Que ferait vivre l’espace d’une grande ville à ces personnages-là ? Au début, l’idée était de ne jamais donner de fin à ce projet comme si il s’agissait de quelque chose de perpétuel qui reviendrait de temps à autre. Mais il y a aussi cette impression que nous n’en sommes pas arrivé au bout et qu’il y aurait encore sans doute d’autres choses à explorer. Progressivement, on s’éloigne de la question du sentiment amoureux au profit d’un rapport à l’autre et au paysage. C’est sans doute une question finalement liée à la dualité plutôt qu’au fait amoureux.
Frédéric Emprou
La Constellation - vers une écologie de l'art - 2017
Avril 2016.
Je débute mon enquëte sur Grégory V. Depuis le début de nos rencontres jusqu’à la performance que je réalise, un objet nous réunit : une table (et même plusieurs tables). L’artiste m’accueille chez lui pour deux séances de conversation. Sur la table du salon : une cafetière posée, des livres de photographies de l’artiste, un ordinateur, mon cahier et mes stylos… Il évoque son parcours de photographe et les pièces qu’il a choisi de montrer en juin à la galerie Confluence. Dans ma propre pratique, la table est une surface essentielle. Je compose généralement mes textes poétiques dans des lieux publics, notamment au café. En amont de l’acte d’écriture, je réalise toujours une forme de rituel : extirper différents objets d’un sac à dos (livres, stylos, cahiers), les disposer sur la table, se placer près d’une fenêtre.
Cette installation scénique est nécessaire, je détermine des conditions d’écriture. Et une autre table surgit, au centre du travail le plus récent de Grégory V. Dans la maison de famille en Touraine, il a retrouvé un carton d’objets ayant appartenu à sa mère (cartes postales, missels, photographies, bijoux, herbes sèches, etc.). Il décide alors de réaliser une pièce vidéographique sur cet atlas intime. Il se filme face à une table en train de disposer, redisposer et ranger ces objets. Avant d’être vidéaste, il faut préciser que Grégory V. est photographe. Il se tient face à une table de montage, surface essentielle dans sa pratique. Il donne à voir les gestes qui précèdent le montage d’une exposition, même si ici, il ne s’agit pas d’images photographiques mais d’objets. Silencieux, il organise, touche, et range ceux-ci, il déploie des constellations d’éléments qui apparaissent et disparaissent sous les yeux du spectateur.
Juin 2016.
Galerie Confluence. J’organise deux séances de présentation de l’enquëte, l’espace vidéographique ne pouvant accueillir qu’un nombre réduit de spectateurs (entre dix et quinze personnes). Je suis debout face à l’auditoire, munie de mes feuilles blanches et d’un jeu d’images. Avant d’entamer ma lecture, je suspends les deux vidéos : sur celle du haut, le regard de l’artiste figé, et sur celle du bas, seule une boîte apparaît. Images arrêtées sur une table pratiquement vide pour pouvoir y inscrire mes propres gestes. Au fur et à mesure, je colle des reproductions photographiques à différents endroits de la table. Je viens alors superposer certaines des photographies qui se trouvent exposées en format original dans la première salle de la galerie, que Grégory V. a dupliquées en format réduit. Deux collections se mêlent : l’atlas personnel de Grégory (photographies réalisées lors de ses marches dans les Pyrénées) et celui de sa mère. Je cherche à présenter ce maillage de trajectoires, sans qu’il soit question de chronologie. Vers la fin de la lecture, je m’assois sur une chaise parmi le public, et je relance la vidéo du bas (voir intégralité de l’enquëte : https://vimeo.com/172914114). Les gestes de l’artiste viennent prendre le relais de mes propres gestes, une chorégraphie se met en oeuvre autour de cette table, qui porte les traces de nos actions, à différents espaces-temps. Dans cette enquëte qui porte sur le travail de Grégory V., je ne cherche pas à proposer une lecture telle une historienne de l’art. Même si, pour élaborer celle-ci, j’ai pensé à Aby Warburg. De 1924 à 1929, il mène une longue entreprise pour constituer un atlas d’images d’histoire de l’art, à l’intérieur de la bibliothèque des sciences de la culture qu’il a créée à Hambourg. Sur différents panneaux en toile noire, il épingle au moyen de petites pinces, de punaises et de trombones un matériel hétérogène et hybride : reproductions et détails d’oeuvres d’art, coupures de journaux, page de livre, cartes à jouer, timbres, cartes postales, photographies, etc. Warburg n’hésite pas à arracher une image à sa catégorie ou à son contexte, il choisit de la découper pour la remonter ensuite dans un maillage d’autres images. Chaque image sélectionnée est extraite de son histoire de l’art, elle peut être agrandie ou réduite (changement d’échelle). Une image n’est pas unique, elle est opérante dans un réseau de relations. Ces planches d’images servent de supports visuels lors des conférences de Warburg. Elles sont support de mémoire à la fois pour l’auditoire et pour l’historien. Warburg réalise trois versions différentes de cette histoire de l’art ; il monte, démonte et remonte ces images.
C’est cette gestualité que je retiens dans son expérience de transmission et dont je cherche à rendre compte en associant performance et espace de transactions. L’expression de la figure de l’artiste dans ses gestes rituels m’intéresse. Et c’est en cela que j’ai perçu Grégory V. tel un curandero. Il se tient à una mesa, objet commun que l’on retrouve chez les populations amérindiennes, en particulier dans les hautes terres du Mexique ou du Pérou. Elle peut être une pièce de tissu, des nattes ou des planches, généralement rectangulaires, posées à même le sol ou sur un support, où l’on place des offrandes et des objets cultuels très divers. Le curandero dispose d’innombrables objets tels que animaux, végétaux, confiseries, boissons, préparations alimentaires, bric-à brac d’images saintes et profanes, statuettes évoquant des personnages ou des divinités précolombiennes, fioles aux préparations multiples, livres de magie noire, varas (cannes sculptées), bijoux, etc. La mesa condense alors un ensemble de singularités, elle contient des réseaux où s’agrègent des entités différentes, et le curandero se livre à des opérations rituelles ou magiques en touchant les objets, en effectuant des pactes, neutralisant ou activant tel objet.
Florence Jou
La Furtive - 2015
Devant les images de La furtive, la lumière s’éteint et j’entends, « c’est mieux comme ça ». Gregory Valton, est derrière moi. J’engage une rapide conversation. L’artiste est un peu tendu mais parle avec enthousiasme.
La furtive est un travail réalisé en 2006-2007 qui a déjà fait l’objet de plusieurs présentations. Il rassemble quelques traces d’une marche de deux cents kilomètres de Terezin (République Tchèque) à Flöha (Allemagne), l’itinéraire à rebours de la « marche de la mort » effectuée par le poète Robert Desnos et ses compagnons d’infortune du 14 avril au 8 mai 1945.
C’est de manière un peu fortuite que Grégory Valton construit ce projet. En novembre 2005, il visite avec une amie biographe de Desnos les camps dans lesquels le poète fut enfermé, de Buchenwald à Flöha, puis la citadelle de Terezin, sa dernière destination. Il écrit qu’à la fin de son parcours, il était « convaincu d’un retour proche et inévitable ». Et dans les mois qui ont suivi, « l’image de la ville n’a cessé de (le) hanter ».
Il est donc revenu en février 2006, moment des photographies de Terezin sous la neige, et a effectué son périple en août 2007. Je retiens de son projet des mots comme traces, signes, morceaux, bribes qui résonnent fortement aux oreilles de l’historien qui n’a que des éléments épars pour penser le passé et doit le reconstituer avec le plus de précision possible. Mais que reste-t-il du passage de Robert Desnos et de la colonne des prisonniers avançant sous les coups des nazis, abattus sommairement et poussés dans le fossé lorsqu’ils étaient au bout de leurs forces. Le paysage des vingt-trois jours du calvaire de Desnos a irrémédiablement disparu. On sait peu de choses de ses derniers moments à Térezin dans un « ghetto dans le ghetto », où « les survivants gisaient, nus sur le sol ou clopinaient à moitié morts à travers des couloirs détrempés et répugnants » selon les mots du journaliste Meyer Levin qui le parcourt le 7 juin, la veille de l’arrivée de Desnos, un jour aussi avant l’entrée de l’Armée rouge (Annette Wieviorka, 1945. La découverte).
À Térezin aujourd’hui, la ville cherche à s’échapper de son triste passé. Hors les murs, il ne reste rien de ce « tréfonds de l’enfer ». Les images de Grégory Valton constituent des métaphores de cette disparition. Des visions morcelées, brouillées. Des détails qui paraissent insignifiants, une fissure, une tache, une ouverture dans un mur, des marques dans la neige. Des photographies de nuit, images partielles, énigmatiques. Un carrefour, une entrée éclairée, mais qu’est-ce qui « se cache dans un angle obscur » ? Même si rien ne nous renseigne précisément sur les lieux, sur le rapport au sujet, on se souvient qu’il s’agit de Robert Desnos, poète et résistant.
Cette photographie du fragment n’a rien d’un projet d’histoire. « Son objet n’est pas la description exacte du passé, mais l’évocation d’une adéquation douloureuse entre le présent et le passé au moment où ce dernier, brutalement, resurgit ». Dans cette phrase qui me semble écrite pour La furtive, Patrick Boucheron s’intéresse aux rapports entre la littérature et l’histoire mais cela s’applique parfaitement à la nature de certains projets photographiques. Un passé qui resurgit, interpelle et entraîne un geste artistique. On touche ici la seconde dimension du projet de Grégory Valton.
« À travers cette expérience, j’ai essayé de m’approcher de Robert Desnos, de sa solitude, écrit-il, en mettant en jeu ma propre solitude et de visualiser les lieux sans me gommer moi-même ». Il ne faut pas prendre cette mise en jeu de soi-même comme une figure de l’art contemporain et la marche de deux cents kilomètres comme une performance. Elle est constitutive de la manière de travailler de l’artiste, de son approche du sujet, comme l’attestent ses travaux ultérieurs. C’est bien la perspective d’une œuvre de mettre en tension l’artiste et son sujet, la marche de la mort et la souffrance infinie que les déportés ont endurées. Comment représenter cette épreuve ? Avec son travail, Grégory Valton se place délibérément au-delà du débat posé par Claude Lanzmann et le caractère indicible et inimaginable de l’extermination et il a raison. Giorgio Agamben a démontré le caractère mystique de cette affirmation et Georges Didi-Huberman a cherché au contraire à « mesurer la part d’imaginable que l’expérience des camps suscite malgré tout, afin de mieux comprendre la valeur, aussi nécessaire que lacunaire, des images dans l’histoire » (dans Images malgré tout). Dans ce débat qui resurgit régulièrement, il faut donc s’intéresser à la manière dont Grégory Valton produit des images et se met à représenter ce qui a disparu.
Son choix de faire la marche à rebours de celle de Desnos constitue le moyen le plus sûr ce ne pas fonder le projet sur un mimétisme qui n’aurait pas de sens et au contraire de la mettre à distance. Symboliquement, au fur et à mesure de sa marche, l’artiste construit cette distance nécessaire qui lui permet de penser et d’agir avec plus d’autonomie par rapport au fardeau de l’histoire. D’autant que parcourir à pied les deux cents kilomètres de Térezin à Flöha est une mise à l’épreuve du corps et de l’esprit. En s’éloignant du ghetto de Térezin, Grégory Valton rencontre la solitude, d’abord celle de l’homme Robert Desnos au milieu d’un convoi de morts-vivants, incapable d’échapper à la brutalité des nazis mais aussi de certains prisonniers, puis la solitude du poète et son œuvre dans ces espaces dénués d’humanité. Enfin, la marche de l’artiste est une interrogation sur l’œuvre à construire, sur les choix esthétiques pour exprimer l’ultime tension entre l’artiste et son sujet. Les images produites témoignent de l’expérience vécue.
Chemins forestiers, masse écrasante du couvert végétal, vastes étendues vides d’hommes et même d’animaux. Dans l’ensemble des photographies de La furtive, tout juste peut-on apercevoir une silhouette, lointaine ou fuyante. Des routes, des sentes, des rails. Impossible de ne pas considérer ces images de rails dans le contexte de la déportation. Le chemin de fer fut sous le régime nazi l’instrument essentiel de leur projet meurtrier.
De cette façon, le travail de Grégory Valton participe au renouvellement des problématiques du témoignage. Alors que les témoins disparaissent, l’histoire bien sûr, mais aussi l’art et la littérature prennent le relais. Ce passage de témoins ne peut plus se réaliser dans le récit, il revient à l’artiste d’inventer de nouvelles formes. Photographier une marche de la mort, celle de Robert Desnos ou d’un autre, « consiste à témoigner de ce qui ne se représente pas, c’est-à-dire cela même dont on ne peut témoigner » (Patrick Boucheron). De là une posture qui cherche dans l’écart et le fragment des formes, artistiques certainement, humaines aussi, empathiques et distantes à la fois.
Yannick Le Marec
Une île, une forteresse - 2015 - Éditions Inculte
Le photographe est venu plusieurs fois à Terezin. Il a reconstitué, à pied, la marche forcée de Robert Desnos jusqu’à la forteresse, ponctuant son périple par des photographies, à l’aide de l’un de ces appareils argentiques où le cadrage se reflète, avant d’être imprimé sur pellicule, dans un petit miroir.
Son âge – la trentaine -, sa vie, rien à ma connaissance ne le destinait à tourner, lui aussi, autour de cette ville. Ça m’absorbe complètement, m’a-t-il pourtant dit au téléphone, longtemps après son retour. Ça a continué à m’habiter pendant des mois. Il y a des lieux qui continuent à vivre.
La mémoire prend parfois des chemins inattendus, investit des terrains imprévus, et Grégory Valton s’est retrouvé à Terezin, obsédé par ce lieu auquel, a priori, rien ne le rattachai.
Il est parti en plein hiver, marcher et photographier, les deux ensemble, indifféremment. C’est à Terezin que j’ai commencé à prendre des photos en marchant, me dit-il. Sous la neige, le temps s’écoule très lentement. On observe tout. La photo a ceci de différent de l’écriture : on a un ressenti très immédiat. Le corps est un peu défaillant. La ligne d’horizon, jamais droite. La dernière photographie de la série a été prise en Allemagne. C’est un portail où il y a écrit « RD », comme les initiales de Desnos. Sur la planche contact, il y a cette image et après, du noir. J’aimerais n’exposer que ça.
Cette espèce de forteresse, poursuit-il, dont on peut faire le tour sans jamais y entrer. Il y a tellement de choses fermées, l’imaginaire est démultiplié. Fouiller, fouiller, fouiller, aller dans des endroits interdits, essayer de passer par-dessus une clôture. Confronté à un lieu sourd, un lieu aveugle, on essaie d’enfoncer des portes, de comprendre, de la comprendre, cette ville, parce qu’elle est incompréhensible. Je serai incapable de la dessiner.
On croise toujours les mêmes personnes. On se demande comment déjouer cette logique parce qu’une ville, ça ne peut pas être logique comme ça, ce n’est pas possible.Il compare Terezin au lac de Grand-Lieu, dans la région nantaise, qui a la particularité de ne jamais pouvoir être observé dans sa totalité – il y a trop peu de points d’accès, de rivages, il faut le voir du ciel pour le voir en entier.
Au bout du fil, je l’écoute, et quelque chose que je n’ai pas encore réussi à nommer commence à s’éclairer. Je pense à Austerlitz, pour qui les forteresses étaient aussi le système défensif de la mémoire, les remparts qui servaient à protéger son amnésie, la perte de sa mère et son déracinement.
Cette espèce de frustration de ne pas pouvoir s’approcher, de ne pas pouvoir comprendre, continue Grégory. Des villes comme Istanbul, Lisbonne, Trieste, on marche toute la journée et on se fait sa propre cartographie, on découvre toujours quelque chose, mais là, c’est une logique qui n’est pas la tienne, on dirait qu’il y a un architecte fou qui a pensé à la place des gens. On cherche s’il y a quelque chose à voir derrière, derrière les casernes, les portes cochères.
Ces remparts avec cette coursive autour, comme une coursive de château. On marche, et on ne voit pas ce qu’il y a derrière.
J’ai commencé la photo après le décès de ma mère, ajoute-t-il. Tous les projets que j’ai pu faire y étaient plus ou moins liés. Je voyageais beaucoup, j’étais toujours dans les trains. Terezin, c’est un peu le gouffre que j’ai ressenti, et qui s’est matérialisé.
Hélène Gaudy
Au départ il n'y a rien qui va de soi - 2015
Chorégraphier le travail, considérer le geste du travailleur comme un geste de danseur… Lorsqu’il pose son trépied et son appareil photo sur le chantier du site Saint-Sauveur , Grégory Valton est précédé par une longue histoire, dont les prémices remontent à la fin du 19e siècle, à un moment où physiologie, danse, photographie et organisation rationnelle du travail opèrent une révolution conjointe… Cette histoire est initiée par Etienne-Jules Marey, médecin réputé, physiologiste et inventeur, qui chercha, tout au long de sa carrière, à perfectionner les instruments d’observation du corps. Un jour, il se fit la remarque que l’on était mieux équipé pour capter les battements du cœur d’un animal que ses mouvements extérieurs, qui échappaient du fait de leur rapidité à l’oeil humain. C’est afin d’y remédier qu’il inventa le chronophotographe, une station permettant de prendre des photographies à intervalles réguliers et rapides, et ainsi de capter les étapes successives de chaque mouvement. Cette invention, ainsi que la décomposition visuelle du mouvement qu’elle permettaient, eurent une postérité aussi formidable qu’inattendue : le cinématographe, l’enseignement de la gymnastique, les marches militaires, le fordisme, la danse moderne, l’aérodynamique… Efficacité, fluidité, puissance, il y a entre les mouvements du danseur moderne et ceux de l’ouvrier une histoire et une nature commune, dont se nourrit l’artiste.
Comment définir un chantier ? Son caractère transitoire, contextuel rend la démarche particulièrement ardue. Dans les Carnets bleus, Ludwig Wittgenstein relève combien certains mots, qui semblent manifestement clairs et concrets, sont pourtant indéfinissables. En prenant l’exemple du mot « jeu », Wittgenstein montre qu’il n’est pas possible de trouver une caractéristique commune à tous les jeux, même si on peut trouver une caractéristique commune pour un sous-ensemble de jeux et si un même jeu peut appartenir à des sous-ensembles différents. Il s’agit, explique le philosophe, d’un « concept aux limites effacées, un concept flou ». Dans ce flou réside néanmoins néanmoins « un air de famille » ou « une ressemblance de famille », une parenté qui s’établit par le biais de la comparaison, de la redondance. Le problème, ainsi posé, rejoint la question de la classification – donc de la définition – des espèces dans les sciences naturelles, qui hésite entre classements « monothétique » et « polythétique ». Le premier recouvre des membres qui possèdent tous un unique ensemble de traits, cherchant à les classer par leur essence, tandis que le second recouvre des individus qui ont le plus grand nombre possible de traits communs, sans qu’aucun trait ne soit nécessaire ni suffisant pour déterminer l’appartenance au groupe.
En fait de chantier, à Rocheservière, c’est à un triple chantier que s’attachent les artistes. Le premier, le plus évident, le plus localisé, est le chantier du site Saint-Sauveur, qui fait sa mue pour devenir un lieu d’accueil pour artistes plasticiens, pour des ateliers… Un autre chantier, moins visible, quoiqu’attaché au lieu, est celui de la résidence d’artistes, dont Grégory Valton et Camille Hervouet sont les premiers invités. L’art n’existe qu’institué, et encore faut-il ici que les artistes trouvent leur place, leur rôle, leur légitimité à intervenir, l’espace dans lequel s’exprimer… Charge aux artistes de se « faire voir », de mettre des visages, des voix, des images sur un métier dont tout un chacun pense quelque chose sans en savoir grand chose. Plus vaste, plus quotidien, moins perceptible sans doute, est le chantier de la communauté de communes de Rocheservière, son « territoire », terme que l’on voit sans cesse apparaître dans les cahiers des charges de projets culturels. Est-ce à dire que le territoire en question existe, ou qu’à la manière de la résidence, il doit lui aussi être institué, par le regard notamment ? La lourde tâche incombe aux artistes, par leur travail, de qualifier les lieux, de mettre, là encore, des visages, des voix, des paysages sur une entité évanescente.
En photographie, il est toujours question de cadre, de plan. De ce point de vue, Grégory Valton a choisi un plan très rapproché, il s’est placé au plus proche du chantier tel qu’on se le représente : les corps des ouvriers au travail, leurs gestes, les transformations du bâti, la charpente qui devient apparente, les parois qu’on abat, les murs que l’on gratte… Il choisit un plan si rapproché que l’on en perd l’objet, derrière un drapé et toutes ces sortes de choses… A l’inverse, Camille a choisi un plan large, un plan si large – le territoire de la communauté de commune – que l’image même y perd sa son évidence, qu’il lui faut inventer le cadre afin de faire image. Trop près, trop loin, trop évident, trop évanescent, de part et d’autre, les deux artistes font face à un même risque de ne pas parvenir à produire de l’image, à rendre visuellement l’objet du regard. Poser des images sur des réalités intangible, n’est-ce pas là l’enjeu même de la résidence ?
Au beau milieu du chantier, Le trépied et l’appareil photo installés au milieu de la salle, Grégory filme des corps au travail, ou plutôt des parties de corps, d’outils, de gestes, tant ceux-ci débordent du cadre. Au gré de ses passages, il filme des phases, des étapes, une évolution de l’espace qui n’apparaîtront cependant pas à l’image. Lui qui est photographe, adepte des plans larges du paysage, des arpentages dans la nature, le voici contraint de sortir de son cadre de travail habituel, de ne pas reproduire « tel quel » ce qu’il voit à travers l’appareil. Unité de lieu, de temps et d’action, régularité des coups de masses, rythmes des corps en mouvement : à l’évidence, le chantier est une scène de théâtre, le film lui-même un chantier qu’il s’agit de monter afin de transcrire cette musicalité, cette théâtralité.
La méthode de Camille est simple : traverser en voiture à faible vitesse les communes de la communauté de commune, à la recherche de chantiers, qu’ils soient publics, comme ce cimetière dont on refait le terrassement, ou privés, comme ce jardin où s’accumulent des palettes. Elle repasse ainsi devant chaque chantier à plusieurs reprises, dans l’attente qu’il présente une conformation plus adéquate, à la recherche d’une lumière spécifique, d’un contact avec le propriétaire du lieu – elle demande toujours la permission avant de prendre une photographie – ou simplement parce qu’elle se demande . Avant toute autre chose, il y a chez elle une manière bien spécifique, patiente et laborieuse, d’aborder son sujet, de l’approcher, d’établir un contact avec lui.
De fait les questions éthiques semblent plus importantes dans sa réflexion que les questions esthétiques, c’est véritablement une question de rapport au sujet, d’honnêteté ou comme elle le dit de sincérité. En général, elle semble s’en remettre à la distance, qu’elle considère suffisante en la matière, du moins lorsqu’il s’agit d’images. Mais ici il y a le texte, et la parole des personnes, qu’elle craint de trahir, là encore à tous les sens du terme. C’est à se demander si sincérité n’est pas l’équivalent de « pudeur ». A la limite, on ressent que le sujet qu’elle aborde la questionne autant, qu’elle ne le questionne, que se pose toujours la question de sa légitimité à le traiter.
Intéressante la réflexion de Camille sur l’absence de profondeur de l’arpentage, de la difficulté de plonger dans le territoire qu’elle aborde de manière assez linéaire, avec la voiture notamment. Elle remarque – et regrette semble-t-il – le réflexe « Google Map » de bonne part des photographes aujourd’hui, qui se substitue à l’arpentage et à la découverte patients du territoire. Il y a ce faisant un paysage qui précède le paysage, une manière de balayer le territoire de manière superficielle, sans chercher à plonger au-delà, qui informe le paysage avant même que celui-ci ait été réalisé.
Il y a un temps de la prise de vue qui importe tout particulièrement aux photographes. chercher le bon angle, repasser si nécessaire plusieurs fois devant un lieu afin de s’assurer de la bonne lumière, déjeuner chaque midi au même endroit afin d’en apprécier les changements, arpenter sans cesse, à la recherche d’un point ed vue… Camille m’explique à ce sujet qu’elle a longtemps refusé de travailler en numérique, qu’elle n’aime pas cette instantanéité, qu’elle aime la prise de risque que constitue le choix de la prise de vue (vie ?). Comment, cependant, une fois le moment passé, une fois la photographie prise, lorsque l’on regarde l’image, aborder ce temps, cette profondeur, ces autres images qu’elle n’a pas prises, comment les ressentir ?
Julien Zerbone
Le pic entre deux ports - 2011
La lumière a été comme avalée, ou plutôt maintenue hors du cadre. Rien d’autre qu’une nature minérale, vieille de millions d’années. Le ciel absent, c’est tout l’espace laissé aux roches grises, à la terre rase, aux parois lisses. L’oppression d’une montagne impénétrable. Pas un seul vivant : des lumières, cependant aux fenêtres, dans une photo de nuit et, dans un champs, une voiture bâchée, inutilisable. Ailleurs, un banc, mais pour quelle rencontre ? Les lieux sont abandonnés aux fantômes.
Car il faut croire que les paysages conservent les travces de ceux qui les ont traversés, le temps d’une existence fugitive. On imagine une jeune fille déjà mélancolique, déambulant sur les chemins dans l’ennui de ses promenades de soirs d’été, passages répétés par les mêmes boucles, l’enserrant plus encore dans leur filet d’araignée. Cette silhouette minuscule au fond d’une vallée écrasante, est-ce la réminiscence de la mère disparue ? Bien longtemps après, son fils, l’oeil dans le viseur de l’appareil photo, passe et repasse sur ces mêmes chemins, et dans la densité frontale de ces terres inhospitalières, fait sourdre l’émotion, comme l’eau glaciale d’un torrent.
Au coeur du projet, un Polaroïd. Un refuge découpe sa masse noire au creux d’une vallée aux couleurs brouillées de neige et de roche. On n’en sait pas plus. Quelle est la date de la prise de vue : aujourd’hui ? Dans le temps d’avant ? De quoi est-ce le refuge ? De retour dans la maison familiale, Grégory Valton ouvre la boîte à chaussures dans laquelle la grand-mère enfouissait ses souvenirs et, au verso d’une carte postale aux teintes forcées, il découvre, écrit de sa main d’enfant : “ Ma chère mamie, je t’embrasse très fort, Grégory “. Avec lui, on avance pas à pas dans la lecture, on presse le bord du gouffre et le voici. La signature de la mère. Son prénom. Hélène. C’est le dehors qui dit la tragédie, le silence et l’enferment de ces montagnes pyrénéennes, Grégory Valton l’a compris. Même à Luz, nom de lumière.
Sylvie Gracia
Dans la neige - 2008
À regarder les photographies de Grégory Valton, on ne sait si l’on se trouve à la tombée du jour ou au petit matin, dans le mystère du commencement ou celui de la fin.
Un sentier se dessine, à travers bois comme une brèche ouverte dans le temps, des chemins se séparent, se rejoignent avant de s’enfoncer dans les arbres. Branchages épais, forêts trouées, neiges fondues au blanc d’un ciel d’hiver : ce sont des verts sombres, velours, des gris doux qui disent la beauté âpre et austère du monde.
En pleine montagne, les roches sont traversées par la coulée des eaux d’un torrent ; d’autres routes encore creusent les terres, se courbent, se penchent, reviennent sur leurs pas, comme pour mieux montrer l’absence, laisser voir ce qui n’est pas, ce qui manque, ce qui ne peut se combler. C’est pourquoi il faut s’absenter, partir, oublier. Se défaire du monde. S’abandonner à l’amère, à la douce mélancolie du voyage. Et puis revenir sur ses traces. Sans langage, sans abri, revenir. Se souvenir. Suivre à nouveau la courbure du chemin. Prendre des photographies comme si ce qui n’était pas vu, ce qui n’était pas montré pouvait à chaque instant disparaître.Être là, et l’instant d’après, n’être plus.
Ainsi la photographie fait-elle écho à la perte, à ce qui est laissé derrière soi, ce dont il faut “ se déprendre “ : un visage entrevu, un paysage hivernal, l’empreinte d’un corps sur un lit. Nulle tristesse pourtant ne perce de ces lieux désertés, ces maisons serrées contre les montagnes ou dans les terres, ces arbres dénudés, courbés sous les rafales, ces murs fissurés d’où pointe la solitude. Juste la beauté subtile, la lumière voilée de ce qui ne se laisse aisément saisir. La photographie se joue alors entre disparition et épiphanie, comme un espace à occuper, un silence vaste, ample, entre ces deux points. Le regard y est tendu, étiré entre l’effacement d’une image et l’apparition d’une autre. Ici, l’ombre fantomatique d’une montagne qui se dérobe, ses flancs abrupts et caillouteux encore enneigés. Là, un cheval blanc qui surgit, solitaire comme un homme, tournant ses yeux vers nous. Talus herbeux, écorce craquelée de troncs rongés de mousse, pierres luisantes affleurant la surface d’un ruisseau, paysages étouffés par les brumes, chambres désertes, alourdies de silence : le temps y est suspendu, retenu, immobile.
Puis d’un coup, le ciel s’ouvre, se fend et laisse place à la lumière crue du jour. Quelque chose se resserre alors : l’image devient abstraite, l’oeil s’approche au plus près des choses, comme s’il voulait toucher la matière tantôt opaque, tantôt transparente du monde, saisir le tremblement de l’instant présent, retenir un reflet, une trace de ce qui a été. Percer un mystère qui n’a pas dit son nom.
Sandrine Bailly
Lendemains - 2005
Dire que la réalité est morcelée est une évidence. Toute réalité l’est, en France, en Serbie et ailleurs. Seul le regard construit parfois les fictions éphémères d’une réalité homogène et signifiante.
Il semble que nous ayons besoin de ces fictions pour vivre, car il nous faut comprendre le monde à grands traits. Même si l’on se doute qu’elles sont à la fois vraies et fausses.
Dire par exemple que le peuple serbe, avide de conquêtes, a succombé à la folie nationaliste et a soutenu les actes de barbarie de ses armées, est à la fois vrai et faux. Milošević a bien été élu, une hystérie nationaliste a bien levé les foules, et les armées régulières et irrégulières ont bien commis des atrocités au nom des Serbes. Mais Milošević a été combattu dans son propre pays avec plus de force que n’importe quel autre potentat des Balkans, le nationalisme fut une hystérie partagée en ex-Yougoslavie et des Serbes innocents ont aussi été victimes de ces guerres.
Pendant des années, les Serbes ont été les bourreaux des Balkans. Ceux qui l’étaient effectivement et, par extension, tous les autres. Face à cette représentation essentialiste, le discours officiel serbe avait lui aussi sa fiction qui était pour l’essentiel une martyrologie agressive. Les deux se nourrissaient et les points de vue autres n’avaient plus lieu d’être.
Voyager en Serbie implique peut-être de trouver un passage entre les fictions spectaculaires, chercher la vie dans les marges et les détours, emprunter d’autres chemins, choisir une représentation autre que frontale, rencontrer des individus plutôt qu’un peuple, fuir les généralités pour le particulier. Et par force, s’interroger sur son propre regard, quitte parfois à se perdre.
On est peut-être dans l’incapacité de construire une fiction, ou bien on les observe défiler sous ses yeux sans que l’on puisse en arrêter une seule. Le flou des situations, l’incongruité des collages, la confusion entre une chose et son reflet, ce que l’on croit deviner sans pour autant en être sûr, les signes auxquels on se raccroche puis qui s’effacent. Tout nous porte vers l’absurde.
Aux lendemains de la guerre, on est incapable de construire une fiction homogène et signifiante, et le pays semble avoir perdu ils siennes. On est au ras de l’existence, la leur et la nôtre.
Comme si l’on se retrouvait sur une plage après une grande marée. Il reste des bouts d’histoires, des morceaux épars, des traces et des signes contradictoire que l’on tente d’interpréter.
Le spectacle est fini et l’on se demande quelle lumière a laissé au pays.
Peut-être que durant ce voyage, le pays nous traverse plutôt que nous le traversons.
On se laisse envahir et on s’en sort comme on peut.
Christophe Dabitch

7 avenue Bascher
44000 Nantes, France
Tel. : 06.15.92.51.32
gregoryvalton@gmail.com
Website
Instagram